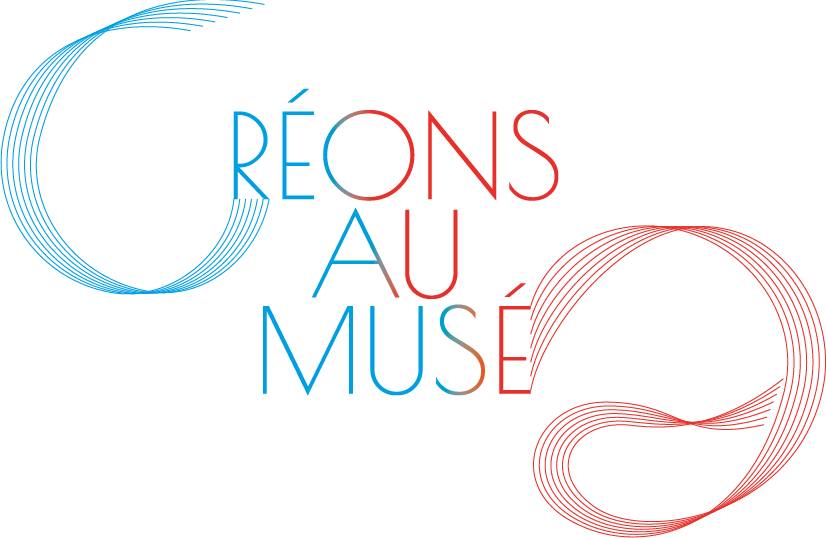Musée National des Arts Asiatiques-Guimet
MERCREDI 30 NOVEMBRE
Parcours de lectures poétiques, musicales, dansées, jouées dans les salles du musée, devant les œuvres
Comment éprouver la saveur (rasa) d’une œuvre artistique ? Comment les performances d’artistes et de chercheurs en théâtre, musique et danse peuvent-t-elles contribuer à une nouvelle approche sensible des œuvres patrimoniales ?
L’objectif est de concevoir, d’expérimenter et d’analyser en milieu muséal les modes de réception des collections permanentes dans un contexte spécifique : lorsque le public est impliqué activement dans une performance théâtrale produite in situ par des artistes du spectacle vivant, pour approcher une œuvre de manière sensible, créative et non seulement didactique et historique.
Parcours 1 : 10h30-11h30 (groupe de 30 personnes)
10h30 Viṣṇu nārāyaṇa reposant sur le serpent de l’Eternité Ananta
Le rasa de l’Amoureux (śṛṅgāra) avec Bhavana Pradyumna, chant carnatique
10h50 Śiva naṭarāja
Poésies, danse et rythme des langues
Shiva Prakash et Wilfried Bosch (traductions)
Sanga (Bharata-natyam et Mohini-attam)
11h10 La Divinité à l’arbre
Triptyque amoureux joué dans le style du Nangyar Kuttu (Kutiyattam)
Viviane Sotier-Dardeau et Rodrigo Casillas
Parcours 2 : 11h 30-12h50 (groupe de 30 personnes)
11h30 La Divinité à l’arbre
Entre sculpture et poésie: shâlabhanjikâ, la muse éternelle, avec Vijaya Rao
11h50 Viṣṇu Garuḍāsana
Histoire dansée et jouée de Gajendra Moksha
Anupama Hoskere (Marionnettes du Karnataka) et Divya Hoskere (Bharata-natyam)
12h15 Gaṇeśa
Le Ganesh paran, avec Antoine Bougeau aux tablas
12h30 Tête de Jayavarman VII
Un écho de śānta rasa, avec Colette Poggi
MARDI 7 JUIN
Parcours de lectures poétiques, musicales, dansées, jouées dans les salles du musée devant les œuvres
Comment éprouver la saveur (rasa) d’une œuvre artistique ? Comment les performances d’artistes et de chercheurs en théâtre, musique et danse peuvent-t-elles contribuer à une nouvelle approche sensible des œuvres patrimoniales ?
L’objectif est de concevoir, d’expérimenter et d’analyser en milieu muséal les modes de réception des collections permanentes dans un contexte spécifique : lorsque le public est impliqué activement dans une performance théâtrale produite in situ par des artistes du spectacle vivant, pour approcher une œuvre de manière sensible, créative et non seulement didactique et historique.
10h30 Viṣṇu nārāyaṇa reposant sur le serpent de l’Eternité Ananta
Le rasa de l’Amoureux (śṛṅgāra) avec Bhavana Pradyumna, chant carnatique
11h30 La Divinité à l’arbre
Entre sculpture et poésie: shâlabhanjikâ, la muse éternelle, avec Vijaya Rao
11h50 Viṣṇu Garuḍāsana
Histoire dansée et jouée de Gajendra Moksha
Anupama Hoskere (Marionnettes du Karnataka) et Divya Hoskere (Bharata-natyam)
12h15 Gaṇeśa
Le Ganesh paran, avec Antoine Bougeau aux tablas
Parcours 2 : 11h 30-12h50 (groupe de 30 personnes)
12h30 Tête de Jayavarman VII
Un écho de śānta rasa, avec Colette Poggi
« L’être-ensemble dans l’espace muséal : une performance de la disparition/recréation de l’œuvre »
Conférence-performance avec les étudiants du séminaire de Katia Légeret en théâtre, Paris 8, présentée sur la scène du Théâtre de la Commune à Aubervilliers le 9 décembre 2015, dans le cadre du colloque « Développement de l’être-ensemble dans les arts performatifs contemporains ? », organisé par E. Beaufils avec le soutien du Labex Arts H2H et de l’université Paris-Lumière, 8-10 décembre 2015, puis restitué et analysé par Katia Légeret dans le colloque Développement de l’être-ensemble dans les arts performatifs contemporains II, organisé par E. Beaufils au CNDC (avec les soutiens de l’équipe d’accueil, du Labex Arts H2H, des universités de Montpellier et de Paris 10, et du Centre National de la Danse d’Angers), 16-18 juin 2016.
Cette performance a fait l’objet d’un film réalisé par Eric Veschi en 2016
Synopsis :
Au musée, le spectateur approche en général une œuvre plastique de culture étrangère grâce à un texte ou à un discours historique et didactique. Comment les artistes du spectacle vivant peuvent-ils l’inviter in situ à devenir l’acteur de sa propre relation à l’œuvre ? Que lui apporte une telle interprétation collective, corporelle et poétique dans un parcours muséal ?
Des jeunes chercheurs du département théâtre (séminaires avec Katia Légeret) et de l’EA 1573 à Paris 8, témoignent d’un « être-ensemble acteurs-spectateurs », qui a pour vocation de recréer collectivement une œuvre plastique muséale en la jouant. Leur savoir-faire est d’ordre rythmique, il privilégie le geste et la langue poétique. L’élaboration de cette conférence-performance a commencé en octobre au MNAAG, autour de trois sculptures asiatiques. Ce colloque sera l’occasion de partager avec le public ce processus de création, qui questionne notamment le déplacement du regard ethnocentrique, la posture d’héritiers, la fonction actuelle de ces mythes, la disparition/transformation de ces œuvres par la transmission orale en tant qu’acte patrimonial immatériel.
Ce « faire-ensemble » produit une complexité performative sans contrainte disciplinaire, afin que l’œuvre muséale fossilisée a priori dans l’espace institutionnel ne soit plus au centre du regard mais disparaisse dans un processus collectif sensible, interactif et non linéaire, qui accepte l’hétérogène, le chaotique, l’altérité, le changement, la méconnaissance des codes culturels. Etudier l’œuvre consiste à la tisser de manière transartistique et transculturelle, jusqu’à ce qu’elle ré-apparaisse autrement, mais vivante.
SAMEDI 21 MAI
Lectures interprétatives (Histoire de l’art) des œuvres choisies par Cécile Becker, chef du service culturel et pédagogique du MNAAG-Musée National des Arts Asiatiques-Guimet
21h Shiva Natarâja (Tamil Nadu, XIe siècle) Nancy Boissel-Cormier (JNU Inde/Paris 8 Edesta), théâtre dansé Bharata-Natyam Bhairava, forme terrible de Shiva (Karnataka, XIIIe siècle) Géraldine Margnac (Paris 8 Edesta), théâtre dansé Bharata-Natyam
19h30 Divinité féminine Art khmer, style de Preah Ko Cambodge, temple de Bakong Viviane Sotier-Dardeau (UFC/ Paris 8 Edesta) en théâtre dansé Nangyar Kuthu (forme féminine du Kutiyattam, Kerala, Inde), accompagnée au miravu (percussions) par Rodrigo Casillas
21h30 Barattage de l’Océan de lait, Fragment de tympan. Cambodge Prasat Phnom Da, district de Prei Krabas, province de Ta Keo, style Angkor Vat, 1ere moitié du XIIe siècle Nathalie Le Boucher, artiste conteuse et actrice du théâtre dansé kathakali
20h Divinité à l’arbre (Madhya Pradesh ou Rajasthan, X-XIe siècle) Sangeeta Dileep et K.J. Dileep, violoniste et chanteuse carnatique (Mysore/Chennai) Avec la participation de Manochhaya-Katia Légeret (Paris 8), théâtre dansé Bharata-Natyam
22h Shiva Natarâja (Tamil Nadu, XIe siècle) Nancy Boissel-Cormier (JNU Inde/Paris 8 Edesta), théâtre dansé Bharata-Natyam Bhairava, forme terrible de Shiva (Karnataka, XIIIe siècle) Géraldine Margnac (Paris 8 Edesta), théâtre dansé Bharata-Natyam
20h30 Divinité féminine Art khmer, style de Preah Ko Cambodge, temple de Bakong Viviane Sotier-Dardeau (UFC/ Paris 8 Edesta) en théâtre dansé Nangyar Kuthu (forme féminine du Kutiyattam, Kerala, Inde), accompagnée au miravu (percussions) par Rodrigo Casillas
22h Shiva Natarâja (Tamil Nadu, XIe siècle) Nancy Boissel-Cormier (JNU Inde/Paris 8 Edesta), théâtre dansé Bharata-Natyam Bhairava, forme terrible de Shiva (Karnataka, XIIIe siècle) Géraldine Margnac (Paris 8 Edesta), théâtre dansé Bharata-Natyam
La performance théâtrale – Nuit des musées 2016 – Nathalie Leboucher.
La performance théâtrale – Nuit des musées 2016 – Manochhaya avec Sangeeta & K. J. Dileep.
La performance théâtrale – Nuit des musées 2016 – Manochhaya avec Viviane Sotier-Dardeau & Rodrigo Casillas.
La performance théâtrale – Nuit des musées 2016 – Manochhaya avec Sangeeta & K. J. Dileep.
La performance théâtrale – Nuit des musées 2016 – Nancy Boissel-Cormier & Géraldine Margnac.
22 MARS
L’entrée dans l’espace muséal : créer les conditions sensibles d’approche de l’œuvre et y inviter le public
Parcours artistique avec les œuvres du Cambodge, dans la salle khmère du musée national des arts asiatiques-Guimet : conter l’épopée du Râmâyana à partir des personnages sculptés et des acteurs présents
Comment transformer l’espace muséal en scène cosmogonique. La fonction de la poésie et du geste dans la rencontre sensible avec les sculptures du musée Guimet Á partir de performances sur le Râmâyana mises en scène par Katia Légeret, une quarantaine d’étudiants en théâtre de Paris 8 (Licence/master/doctorants EA 1573), avec la participation d’artistes en bharata-nâtyam, produiront une performance in situ dans la grande salle d’exposition à l’entrée du musée, consacrée en majorité à des sculptures du Cambodge. La propédeutique, qui sera mise à l’épreuve par ce processus expérimental, vise à créer un parcours entre 3 œuvres khmères (X-XIIè siècle), à partir du récit du Râmâyana et sa traduction en français (Gallimard/La Pléiade, 1999). Le texte littéraire sera mis en résonance avec la tradition orale sanscrite de la transmission en Inde et au Cambodge. Une « traduction » contemporaine des langages corporels sera présentée, tenant compte des habitus culturels et des langues de ces jeunes acteurs venant de plusieurs pays. La question d’une transposition interculturelle de ces récits qui viennent de l’Inde sera posée, notamment avec la mise en scène de contes amazoniens dirigée par Monique de Boutteville, reliant individu et cosmogonie avec les pratiques du conteur amazonien. Un regard synesthésique du patrimoine et des résonnances transculturelles. D’autres cultures minoritaires telle la langue des signes (LSF) sont invitées à participer avec la performance d’Olivier Schetrit et par la proposition de Muriel Roland, qui s’intitule « Que murmure à nos corps d’acteurs le Bouddha paré protégé par le nâga? : contemplation mimétique, transmission sensible et connaissance de l’Énergétique chinoise, Mettre en présence les corps et restaurer leurs géométries brisées ».